Comment bloquer le pays ? Quels enseignements tirer du mouvement « Bloquons tout » ? Olivier Besancenot (ex-porte parole du NPA) et Simon Duteil (ex-porte parole de Solidaires) analysent la nouvelle séquence de mobilisation ouverte depuis le 10 septembre et esquissent des perspectives pour l’après 18 septembre.
Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 200 000 personnes ont participé à la journée du 10 septembre, construite en dehors des cadres traditionnels de mobilisation. Pour ce jeudi 18 septembre, les renseignements territoriaux pronostiquent la présence de 800 000 personnes dans les manifestations. Est-ce que ce sont des signes annonciateurs d’un grand mouvement social à venir ?
Olivier Besancenot : Comme d’habitude, on ne sait pas. Mais il y a des choses positives notables dans le mouvement du 10 septembre. D’abord la participation à des assemblées générales (AG) de préparation. C’est important de voir qu’il y a une auto-organisation dans le mouvement. On avait quand même tous et toutes noté que cela avait manqué en 2023, lors de la bataille contre la réforme des retraites. Même dans les secteurs les plus combatifs, chez les cheminots par exemple, il y avait peu de monde dans les assemblées générales et donc une difficulté à reconduire les grèves.
La pratique des AG est en perte de vitesse depuis au moins le début des années 2000. En 2003, lors de la bataille contre la loi Fillon sur les retraites, je me souviens d’AG interprofessionnelles où on était 800 à 900 à la bourse du travail de Gennevilliers. Les années suivantes s’il y avait 150 personnes, c’était un grand maximum. Est-ce que cette auto-organisation sera durable ? Impossible à dire. Mais on note qu’il se passe des choses, chez les hospitaliers notamment, ou encore dans les région.
Le deuxième élément notable, c’est que le 10 septembre était quand même très jeune. Je pense qu’il y a là confirmation qu’une nouvelle génération commence à s’engager depuis plus d’un an, peut-être sur des thèmes un peu différents.
Simon Duteil : Je dirait plutôt que le 10 septembre révèle la nécessité d’avoir un grand mouvement social. Si l’on n’a pas rapidement une vaste mobilisation, on sait que l’extrême droite est derrière en embuscade. Elle est aux portes du pouvoir et on ne peut pas trop compter sur les organisations politiques de gauche pour réussir à lui faire barrage.
Aujourd’hui, on sent que le fond de l’air est à la mobilisation. Il y a beaucoup de colère et de peur, mais j’ai envie d’y croire. La question demeure posée sur la façon dont peut se dérouler cette séquence. Le 10 septembre était franchement bien, même si on aurait toujours pu espérer plus. Le 18 septembre, si on est proche du million de manifestant.es, cela veut dire que porter un appel unitaire intersyndical large a un impact réel et qu’il y a une dynamique. Maintenant il faut aller plus loin, donner des perspectives pour renforcer la mobilisation et surtout la grève.
Le mouvement du 10 s’était fixé comme stratégie le blocage du pays, plutôt que de faire nombre dans des manifestations, jugées par beaucoup peu efficaces pour gagner. Or, si on a pu observer de très nombreuses tentatives de blocage, peu ont réussi face à la pression policière. A l’inverse, ce sont plutôt les manifestations qui ont été marquantes par leur taille. Est-ce que cela remet en cause les stratégies de blocage ?
Simon Duteil : La très bonne nouvelle, c’est que le 10 septembre a largement diffusé l’idée que pour changer les choses, il faut parvenir à un blocage de l’économie. Les syndicalistes de lutte et de transformation sociale le portent depuis longtemps. La question qu’il faut discuter avec le plus grand nombre, c’est : « comment on y parvient ? »
Il y a parfois une forme de pensée magique – diffusée aussi par des courants politiques – qui est substitutiste. Elle sous-entend qu’il suffit de bloquer tel ou tel endroit pour gagner. On a pu avoir ce type de choses par le passé autour des raffineries par exemple. Je pense profondément que le blocage de l’économie, c’est avant tout par la grève que cela s’organise et qu’on l’obtient.
C’est avant tout parce que les gens arrêtent de travailler qu’il y a blocage et que ça libère du temps pour le mouvement. Bien sûr, il peut y avoir des blocages ponctuels de telle ou telle zone, mais je ne crois pas à une construction depuis l’extérieur. Tu ne bloques pas le port parce que tu vas bloquer le port avec quelques personnes. Tu le paralyses parce que les travailleurs et les travailleuses du port s’arrêtent de travailler.
Beaucoup disent « les grandes manifs pendant les retraites, ça n’a pas marché ». Évidemment, cela n’a pas été suffisant et nous avons perdu. Mais ce que l’on n’a pas réussi en 2023, alors que l’on l’a essayé, c’était de lancer le blocage de l’économie à partir du 7 mars. Nous n’avons pas été capables d’avoir assez de personnes en grève et surtout des assemblées générales pour pouvoir décider des suites. Si on attend juste des dates qui tombent d’en haut, on ne risque pas de gagner.
Olivier Besancenot : Les gilets jaunes, les retraites… quand tu pars avec, derrière toi, globalement des échecs, forcément tu cherches d’autres choses. Y compris avec une part d’illusion sur le fait qu’il faut renoncer à la grève ou à l’organisation sur le long cours.
Mais on a aussi des mouvements sociaux qui cherchent légitimement comment faire pour peser, un auto-apprentissage qui est important. Le mouvement hérite aussi de quelque chose de profond : la diminution depuis les années 1970 du nombre de journées de grève. Parce que le salariat n’est plus le même, parce que les statuts ne sont plus les mêmes, parce qu’il y a aussi un délitement du mouvement ouvrier. Alors il n’y a pas de solution miracle en la matière. Intuitivement, je dirais qu’il y aura probablement des combinaisons de différentes modalités d’action, y compris certaines qu’on n’envisage pas encore.
Ce qui a également été marquant le 10 septembre, c’est la forte mobilisation de la jeunesse. Ce n’était pas le cas lors des réformes des retraites en 2019 et 2023 ou même au moment des Gilets jaunes. Est-ce que cela marque une rupture ?
Olivier Besancenot : On a le droit de s’enthousiasmer pour des événements positifs. Sur le centre de bus RATP Belliard du 18e arrondissement où j’étais, ce n’était que des grappes de jeunes qui venaient. Ils étaient en contact sur des boucles, qui allaient bloquer le périphérique, qui revenaient.
Toute proportion gardée, au moment des législatives il y a quelque chose qui s’est passé contre le RN qui a joué dans la victoire du NFP, ça a été un des points de bascule. Sur la Palestine sur le terrain internationaliste, on ne voit qu’eux. Sur le terrain féministe, c’est pareil.
Dans cette nouvelle période de transition, qui est frustrante par nature, c’est l’enjeu fondamental. Il faut que la connexion s’effectue avec le restant du salariat organisé ou non. C’est quelque chose d’extrêmement positif parce que par nature un mouvement de jeunesse c’est imprévisible.
Simon Duteil : J’espère que cela révèle une capacité d’action d’une jeunesse qui n’a pas envie de subir les politiques rétrogrades et antisociales. Mais aussi d’une jeunesse qui voit l’urgence écologique et a à cœur les luttes contre les discriminations et pour l’égalité réelle (féministes, anti-racistes, anti-validistes, LGBTQIA+). Cette jeunesse conscientisée voit bien que la situation générale est celle de la montée du fascisme. Et donc qu’il y a une nécessité à se mobiliser.
Maintenant, je ne sais pas quelle forme cela peut prendre. Il y a longtemps que l’on n’a pas vu un mouvement étudiant important par exemple. Les universités ont beaucoup changé et les capacités d’empêcher un mouvement étudiant sont devenues énormes. Il suffit de regarder la vitesse avec laquelle la police intervient maintenant sur les campus. Donc, il y a des facteurs qui freinent, mais il y a aussi une colère sourde et la volonté de ne pas se laisser imposer un avenir de merde.
Malgré le succès de Bloquons tout, il y a eu assez peu de rebonds entre le 10 septembre et la date intersyndicale du 18 septembre. Par ailleurs, les assemblées générales ne se sont pas élargies depuis les manifestations. Est-ce que les modalités d’action où et les formes d’organisation de « Bloquons tout » ne sont pas adaptés pour accueillir la masse des personnes mobilisées le 10 ? A contrario, est-ce que cela traduit la faible volonté du plus grand nombre à s’organiser ?
Simon Duteil : Ce sont les semaines qui viennent qui nous le diront. Si jeudi des AG de grévistes disent à certains endroits « il faut que ça continue, on s’organise, on tente, on lance », cela va susciter un intérêt fort.
Après, pour ce qui est de la participation aux AG, ce qui est compliqué, c’est quel est ton niveau d’AG. Tu peux faire une assemblée générale sur ton lieu de travail, des AG de tous les travailleurs d’une catégorie à l’échelle d’une ville ou de grévistes au niveau interprofessionnel. Pour autant, il y a des biais. A Saint-Denis où je suis, on a eu, par le passé, des assemblées générales interprofessionnelles superbes avec des grévistes de plein de catégories. Mais d’autres fois, des AG interprofessionnelles composées surtout d’enseignantes et enseignants. Au lieu de discuter de la capacité de mettre en grève son secteur, elles voulaient agir à l’échelle de la ville, mais finalement sans développer la grève.
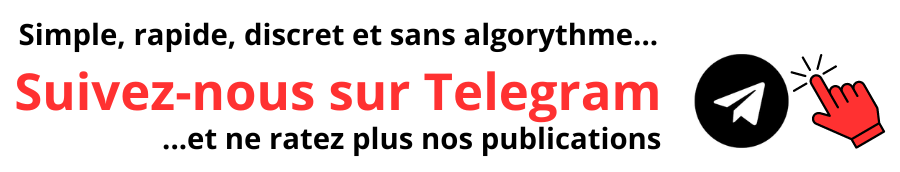
De fait, l’appel « Bloquons tout » permet d’agir en dehors des cadres qui viendraient d’en haut, avec une construction à la base. Mais effectivement, il n’y a pas eu un engouement énorme sur les différentes AG après le 10, de ce que j’ai pu voir. Est-ce qu’il faut continuer à faire des petits blocages ? Bloquer telle autoroute ou tel périphérique va certes être visible, mais va exposer à des risques majeurs, avec une police ultra violente, sans assurer un rapport de force dans la durée. En tout cas, pas à l’échelle voulue.
S’il y avait 3 millions de personnes en train d’y participer, je ne dirais pas exactement la même chose évidemment, mais aujourd’hui on n’est pas sur cette masse là. Cependant, si ça se développe et que l’étincelle du 10 devient un feu qui brûle durablement, je pense qu’il y aura beaucoup plus d’assemblées qui existeront.
Au sein de la dynamique « Bloquons tout », il existe une certaine méfiance vis-à-vis des organisations syndicales et des critiques des dates qui tombent d’en haut, des journées « saute-mouton » (ndlr : journées de grève espacées dans le temps), voire une défiance vis-à-vis de l’intersyndicale ou des composantes de celle-ci. De l’autre côté, certains syndicats ont pris leur distance avec ce mouvement. Est-ce que les deux dynamiques sont condamnées à ne pas additionner leurs forces ?
Simon Duteil : Évidemment, l’intersyndicale est large et tout le monde ne poursuit pas exactement les mêmes objectifs. La CFDT n’est pas un syndicat de lutte et de transformation sociale. Mais je ne vois pas l’intérêt non plus de dire que c’est un syndicat qui va trahir. Aujourd’hui, il est important d’avoir un appel intersyndical fort, qui dise qu’il n’est pas normal que les travailleuses et travailleurs doivent toujours payer plus, qu’il y a d’autres solutions. C’est un point d’appui pour aller plus loin. Effectivement si l’intersyndicale n’est pas capable d’appeler rapidement à quelque chose d’autre après le 18, on pourra se dire que ça ne servait pas au mieux. Mais ce n’est pas contradictoire avec le mouvement Bloquons tout.
Le fait qu’il y ait des discours antisyndicaux peut s’expliquer par une vision un peu éloignée de ce qu’est le syndicalisme. Mais en réalité, si un mouvement social fort prend, tout cela va être submergé. L’énergie de la mobilisation emportera tout. Il y aura des AG de grévistes, plein de manifestations, une visibilité dans les villes, dans les campagnes, dans tous les endroits où il se passera quelque chose et ça débordera.
Tout le monde ne jouera pas la même partition, mais ce qui compte, c’est qu’il y ait la construction d’une mobilisation. Tout le monde sent qu’il y a cette nécessité et ça donne de l’énergie. C’est pareil pour la critique des journées « saute-mouton » (ndlr : journées de grève espacées dans le temps). Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que je ne vois pas à quel endroit, comme ça, d’un coup, tout le monde part en grève reconductible sans préparation.
Donc oui, il faut avoir des journées qui permettent de faire un point d’appui, de se compter, d’emmener plus de travailleurs, de convaincre plus de monde, de se dire « oui, on peut gagner ensemble » et de redonner confiance. Par contre, ça ne doit pas être la seule tactique et on en revient à la question du blocage de l’économie. C’est la grève généralisée et la capacité de bloquer qui fera gagner. Par conséquent, je n’oppose pas les deux.
Olivier Besancenot : La radicalisation du camp d’en face nous oblige à nous retrouver. Mais pour cela, il faut mettre de l’huile dans les rouages. Nous avons besoin de pratiques militantes qui existent souvent plus localement qu’à l’échelle nationale. Par exemple, voir des collectifs LGBTI dans les mouvements sur les retraites ou des pink blocs dans les manifestations – tout ça dans une bonne ambiance – je suis pas sûr que, il y a 10, 15 ou 20 ans, c’était envisageable.
Quand je suis passé à Tours, je voyais des cheminots CGT et SUD, justement avec ces mêmes collectifs, faire des collectes pour la grève et parler d’une même voix dans des réunions publiques. Tu peux multiplier les exemples entre certains secteurs féministes, écologistes ou dans les collectifs de quartier. Je ne vais pas amplifier le réel, évidemment il a plein de contradictions, de débats, de désaccords, de clivages, mais il y a aussi cette activité de fourmis qui existe.
La journée du 18 septembre s’annonce forte, voire très forte. Quels sont les éléments qui permettraient d’augmenter significativement le rapport de force face à l’exécutif après cette date ?
Simon Duteil : Outre ce que fait le gouvernement lui-même, et qui attise la colère, c’est notre capacité à sortir d’une forme de sidération. La succession des différents gouvernements et la situation internationale ont un impact. On voit monter partout des gouvernements post-fascistes, très autoritaires, y compris dans des endroits où on ne les attendait pas.
Ce qui peut augmenter le rapport de force, c’est que les gens se disent que nous pouvons reprendre nos vies en main. Qu’en tant que travailleuses et travailleurs, en tant que population, nous avons ce pouvoir là. L’intérêt de la journée du 10 septembre a été de montrer qu’il y avait une envie de ne pas se laisser faire. L’importance de celle du 18 est de montrer qu’il y a un large spectre de colère et qu’il y a des revendications.
Ce qui fera la différence, c’est : est-ce qu’on est capable le 18 et dans les jours suivants de discuter sur les lieux de travail et dans les villes pour savoir comment on fait en sorte de ne pas attendre un mois ou deux. Il faut profiter du fait qu’il y ait cette colère et cette énergie pour aller plus loin. On ne rentre pas chez soi normalement, on ne retourne pas au travail normalement, on trouve des modalités pour faire dérailler le train du quotidien et pour imposer d’autres choses que ce qu’on est en train de subir.
Olivier Besancenot : Cela va dépendre de la force du 18 septembre. Selon de premiers retours, il semble que les taux de grève ne seront pas ridicules. Mais aussi que l’ambiance n’est pas non plus à la reconductible. Donc, je ne sais pas. J’ai vu des appels pour le dimanche suivant à occuper des places qui commencent à tourner. Est-ce qu’il ne faut pas, à un moment donné, envisager quelque chose de l’ordre de la démonstration de force avec une marche nationale ?
Mais derrière la crise politique et l’aspect anti-Macron, la question mobilisatrice est celle de la répartition des richesses. C’est toujours les mêmes qui payent et c’est toujours les mêmes qui profitent. Maintenant, il faut que ça s’arrête ! Il faut envisager quelque chose qui permette d’être unitaire, d’accompagner le mouvement sans se substituer à lui.
Une dernière chose à ajouter ?
Olivier Besancenot: J’en remets une louche sur la répression. C’est aussi un des éléments qui peut mettre le feu aux poudres. En mai 1968, c’était avec l’évacuation de la Sorbonne par exemple. Dans la radicalisation du pouvoir, comme dans la crise politique et la vacance de gouvernement, l’interlocuteur c’est Bruno Retailleau, avec ses ambitions politiques. Il serait bon que des réseaux unitaires se mettent pour de bon pour lutter contre la répression. On peut le faire dès maintenant car on sait qu’elle est plantée dans le décor.
Simon Duteil : Je pense que tu ne construis pas des mobilisations de masse sans avoir de réflexions sectorielles sur des revendications spécifiques. Typiquement, je suis dans l’éducation dans le 93. Là, c’est la remise en avant du plan d’urgence 93. Il nous faut des éléments construits pour dire « c‘est ça dont on a besoin, c’est ça qu’on veut ». Nous voulons l’abrogation de la réforme des retraites, mais aussi le renforcement des services publics et on doit être capable de le quantifier.
Quand on voit la France insoumise, ou d’autres, dire le 10 septembre c’était pour dire au revoir à Bayrou, que le 18 ce sera pour dire au revoir à Macron, ce n’est pas le sujet. Le sujet n’est pas Macron, mais le partage des richesses.
Interview et retranscription : Guillaume Bernard et Stéphane Ortega
Faisons face ensemble !
Si les 5000 personnes qui nous lisent chaque semaine (400 000/an) faisaient un don ne serait-ce que de 1€, 2€ ou 3€/mois (0,34€, 0,68€ ou 1,02€ après déduction d’impôts), la rédaction de Rapports de force pourrait compter 4 journalistes à temps complets (au lieu de trois à tiers temps) pour fabriquer le journal. Et ainsi faire beaucoup plus et bien mieux.

