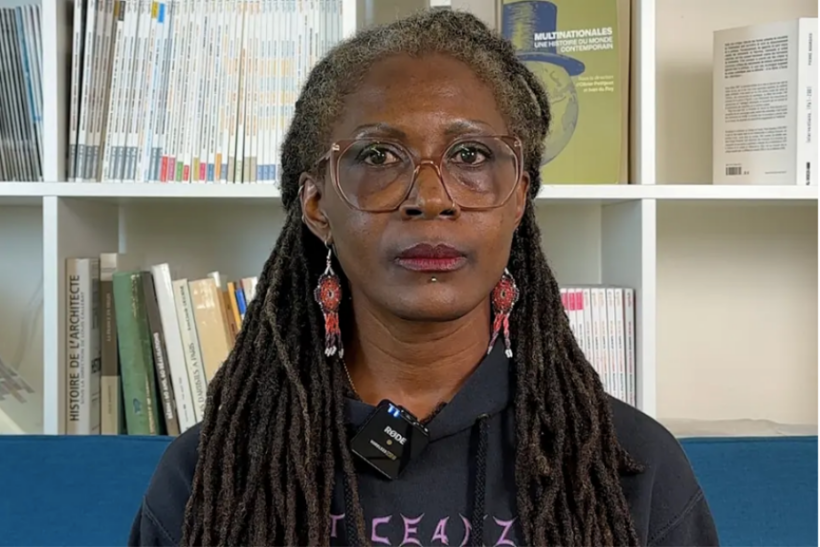Le 17 juin 2007, Lamine Dieng meurt étouffé par des policiers à Paris. Fatou Dieng, l’une de ses sœurs, revient sur ce drame qui a nourri son combat contre les violences policières. Une lutte qu’elle mène aux côtés d’autres familles de victimes. Vingt ans après la mort de Zyed et Bouna, où en est cette bataille collective ?
Propos recueillis par Ivan du Roy et Ludovic Simbille.
Cet article est publié dans le cadre de notre partenariat avec Basta!.
Le 17 juin 2007, Lamine Dieng, est arrêté par la police devant un hôtel du 20e arrondissement de Paris. Ce Franco-Sénégalais de 25 ans meurt après avoir été maintenu dans un fourgon de police, attaché et asphyxié sous le poids de cinq fonctionnaires agenouillés sur lui pendant plus de vingt minutes.
Après treize années de bataille juridique, plusieurs non-lieux et un classement sans suite, la famille a décidé de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme. Un accord amiable a finalement été trouvé en 2020 avec l’État français, qui s’est engagé à verser 145 000 euros à la famille Dieng au titre de dommages et intérêts. Depuis près de vingt ans, ses sœurs, Ramata et Fatou Dieng, sont de toutes les mobilisations contre les violences d’État.
Basta! : Que représentent pour vous la mort de Zyed et Bouna puis les révoltes urbaines qui ont suivi à l’automne 2005, deux ans avant la mort de votre frère ?
Fatou Dieng : J’étais évidemment consciente de ce que les jeunes garçons noirs, arabes ou rroms pouvaient subir en matière de contrôles de police à répétition. L’inquiétude était effectivement forte vis-à-vis de mes frères, qui étaient des cibles potentielles de ces contrôles au faciès dans l’espace public. Zyed et Bouna auraient pu être mes petits frères.
Mais je n’imaginais pas alors que, deux ans plus tard, Lamine serait tué par cinq policiers. Cela me renvoie aux conseils que mes parents donnaient aux garçons [Fatou avait trois frères, ndlr] du genre « faites attention, ne sortez pas sans votre pièce d’identité ». Ce sont les jeunes garçons qui étaient les plus visibles dans l’espace public. Les filles, traditionnellement, sortaient moins. Je me vois reproduire cela avec ma fille, depuis son adolescence.
Aujourd’hui, elle est une jeune femme noire voilée de 30 ans et mon inquiétude reste aussi grande que celle de mes parents. Elle n’est pas à l’abri, donc je lui dis souvent de faire attention en voiture et de faire profil bas pour se préserver de tout contact avec la police. Pour moi, les révoltes urbaines sont une réponse de colère, d’indignation face aux violences et crimes d’État. Les condamner serait nous condamner. Une vie humaine n’a pas de prix et ne peut être remplacée.
Votre perception de la police était donc, à l’époque, déterminée par ce que vous disaient vos parents ?
Oui, une perception de la police bien déterminée par les recommandations et mises en garde de nos parents, mais aussi de ce qu’on pouvait observer à l’extérieur et dans les médias concernant les violences policières. Je pensais qu’on était plutôt à l’écart, du fait que mes frères étaient tous majeurs. Même si on n’était pas militants, ce n’est pas pour autant qu’on était insensibles, on voyait les contrôles. Comme dans tous les quartiers, les policiers connaissaient les jeunes et les appelaient par leur prénom, leur nom de famille. Alors quand les policiers du quartier disaient avoir mis 36 heures pour identifier Lamine… Quand ma petite sœur s’est aussi retrouvée en garde à vue dans ce même commissariat (Paris 20e), ils savaient très bien qui elle était.
En 2007, vous créez le Collectif pour Lamine puis Vies volées en 2010, qui réunit plusieurs familles dont un proche a été tué par les forces de l’ordre. Où en étaient, alors, les mobilisations contre les violences policières ?
Par l’intermédiaire d’une cousine, nous avons été mis en lien avec la Brigade anti-négrophobie [créée en 2005, ndlr] et le Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB) et d’autres collectifs. En 2007, il n’y avait pas toutes les ressources qu’on trouve aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Toutes ces rencontres physiques nous ont permis de nous renforcer et d’organiser une marche blanche en à peine une semaine. Le collectif Vies volées est le fruit de toutes ces rencontres que ma sœur Ramata a alors faites avec d’autres familles, d’autres comités locaux, pour justement montrer que ces morts n’étaient pas isolées et pour créer une mobilisation.
Quand on est frappé par un tel drame, comment trouve-t-on l’énergie pour se mobiliser, pour chercher à savoir ce qui s’est passé, pour se coordonner avec d’autres familles dans la même situation ?
On avait le choix de ne rien faire, mais, pour nous, c’était impossible. Il fallait absolument avoir des réponses à nos questions. Plein de choses n’allaient pas dans la version officielle. Déjà, le fait d’être contacté 36 heures après les faits, alors que cela s’est passé à 500 mètres du domicile familial ! Et par téléphone… Annoncer cela sans savoir si la personne au bout du fil est alors en mesure d’entendre que son fils ou son frère est mort…
« Accident sur la voie publique » : c’est comme cela que le décès de Lamine nous a été annoncé le 18 juin 2007. C’est vaste… On s’est dit : « Il a dû avoir un accident de moto. » Le 19 juin, nous nous sommes rendus à l’IGPN (IGS à l’époque) pour entendre leur version, toujours sans avoir pu identifier le corps. On a senti que quelque chose clochait. Le premier article, c’était dans Le Parisien, qui titrait « Mort dans un fourgon de police », alors que nous n’étions même pas encore au courant des circonstances.
L’article écrivait : « Overdose de cocaïne. Cannabis, alcool. » On réalisait à peine ce qui nous tombait dessus. Nous étions encore dans le déni : peut-être que ce n’est pas lui, c’est un mauvais rêve… Alors que, déjà, certains tentaient de salir la mémoire de Lamine, de le criminaliser. Cela montrait qu’ils n’avaient aucune considération pour la famille. C’est vraiment déstabilisant et ça met en colère. Pour nous, connaître la vérité était donc primordial. Et pour nos parents, cela a été un soulagement que la cause du décès ne soit pas une overdose.
La première chose ensuite a été de trouver des avocats compétents, recommandés par des militants. Et comme toujours dans ce genre de cas, beaucoup de personnes arrivent avec leurs idées et combats politiques. Les familles à qui ça arrive sont soudainement submergées d’informations. Ce deuil, malgré nous, restait impossible. Nous l’avions vite transformé en combat contre l’injustice et pour la vérité, la justice, la réparation et la dignité.
Ramata et vous, Assa Traoré, Amal Bentounsi, Aurélie Garand, ce sont souvent des sœurs qui portent cette lutte…
C’est vrai. Dans notre cas, c’est vraiment Ramata qui a eu cet élan, qui nous a représentés en tant que fratrie et famille. Ramata était la plus grande des sœurs – c’est pareil pour Assa Traoré –, elle avait ce rôle de « petite maman » aussi. Notre frère aîné n’avait pas cette vision de porter plainte, de batailler en justice. Pour lui, ça ne servait à rien. Les frères s’identifient trop aux hommes tués, à ceux qui subissent ces violences. Les sœurs n’ont peut-être pas la même représentation.
Ma fille avait 12 ans à l’époque, et j’ai des nièces de 5 et 16 ans. Même si elles sont nées beaucoup plus tard, elles connaissent l’histoire de leur oncle et savent qui il était et comment il a été tué. Quoi qu’il arrive, elles auront des questions. Chaque nouvelle affaire de violences policières, que soit une personne blessée ou tuée, nous fait revivre notre propre colère, notre propre souffrance quand on sait par quoi ces familles vont passer au niveau des médias, au niveau juridique et ce que cela peut créer au sein de la famille. À certains moments, il faut savoir lever le pied pour prendre soin de soi et des autres.
Depuis 20 ans, les mobilisations contre les violences policières ont continué de se structurer. Il y a eu les autres collectifs, les comités Vérité et justice, Urgence notre police assassine en 2012, le Comité Adama en 2016… Ensuite, il y a eu l’Assemblée des blessés et des mutilés, les Gilets jaunes. Quel regard portez-vous sur cette évolution ?
L’Assemblée des blessés existait déjà avant les Gilets jaunes et les mutilés pour l’exemple. Suite à l’augmentation des violences d’État, il y a eu effectivement beaucoup d’organisation autour, aussi grâce aux réseaux sociaux. En 2007, il y avait certainement moins de mobilisation ou peut-être moins de visibilité. On est moins isolés aujourd’hui et on peut trouver plus facilement des idées, des outils sur les réseaux. Mais il faut aussi apprendre à faire le tri entre toutes les sollicitations. Ce n’est pas facile. Il y a également des familles qui ne veulent pas être médiatisées. Il faut aussi que ces familles soient entourées, accompagnées malgré tout, tout en respectant leur temporalité et leur choix.
L’autre changement, c’est que les témoins de violences policières n’hésitent plus à sortir leur téléphone pour filmer. Plusieurs passants ont filmé la mort de Cédric Chouviat, ce livreur mort asphyxié par des policiers lors d’un contrôle de police à Paris en 2020, comme d’autres avaient filmé celle de George Floyd aux États-Unis en mai de la même année. Après cette affaire, les gens arrêtaient ma mère dans le quartier et lui disaient : « Vous avez eu raison. Heureusement que vous vous battez parce qu’on a vu le meurtre de Cédric Chouviat, en direct à la télé. C’est la même chose : clef d’étranglement, placage ventral. »
Mais malgré cela, ce qu’on a constaté, c’est que du côté des politiques, ils ne vont jamais vraiment interdire ou modifier une technique ou une pratique policière mise en cause – comme les clefs d’étranglement par exemple – sans la remplacer par autre chose. Nous, à l’époque, on avait écrit à Nicolas Sarkozy [alors président de la République, ndlr], à Rama Yade [secrétaire d’État aux droits de l’Homme, ndlr], à Michèle Alliot-Marie [ministre de l’Intérieur, ndlr]. Il et elles nous répondaient, mais nous avons vite compris que nous ne pouvions rien en espérer.
Christiane Taubira, qui était alors sénatrice, avait fait le déplacement chez mes parents, en adressant ses condoléances et un courrier remis en mains propres parce qu’elle avait saisi la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui a depuis été supprimée.
Malgré l’indifférence du pouvoir politique face aux violences policières, les mobilisations sur ce sujet sont donc davantage visibles ?
Oui, mais il y a quand même des familles toujours isolées. Je pensais à la maman d’Inès, cette jeune femme de 18 ans, tuée en octobre 2022 à Grenoble [à la suite d’un refus d’obtempérer alors qu’elle était passagère du véhicule, ndlr]. Le chauffeur passe en procès en avril prochain. Ou la famille de Rayana [tuée alors qu’elle était passagère d’une voiture qui a refusé d’obtempérer à un contrôle de police en juin 2022 à Paris, ndlr], pour laquelle le chauffeur est passé ce mois-ci en procès. Il n’y a aucun procès encore en vue pour les policiers auteurs de tirs mortels qui ont coûté la vie à ces jeunes femmes. Les mobilisations sont davantage visibles, mais les violences et crimes d’État restent dans la majorité des cas impunis, sans justice ni réparations.
Il y a de plus en plus de familles qui se mobilisent, mais ce n’est pas pour autant que l’évolution se fait dans le bon sens. Parce que le nombre de morts augmente et que le pouvoir du corps policier devient de plus en plus important et intouchable. C’est pour ça que je crains qu’on n’en sorte jamais réellement. Les lois se votent à l’Assemblée. Pourquoi des élus laissent-ils passer ces lois, pour ensuite participer à des marches contre les violences policières ou contre le racisme ? Ils et elles ont quand même une responsabilité. On se sent démunis, mais on reste déterminés.
En 2020, la campagne « Laissez nous respirer » avait élaboré une série de revendications face aux violences policières. Quelles seraient les mesures prioritaires à mettre en œuvre ?
Nous portons plusieurs mesures depuis longtemps. Il y a une revendication qui, si elle pouvait être mise en place, pourrait faire réfléchir les policiers : une radiation définitive des agents ayant tenu des propos racistes ou commis des actes racistes. Ainsi que la suspension immédiate, sans versement de leur salaire, des agents mis en cause pour violence, homicide, propos ou comportement racistes, suivie d’une radiation définitive s’ils sont jugés coupables. On demande également la création d’un organe indépendant de contrôle [à la place de l’IGPN, ndlr]. Ce n’est pas aux policiers d’enquêter sur des policiers. On sait qu’il n’y a pas de neutralité.
Il faudrait systématiser l’audition des témoins par le magistrat ainsi que la reconstitution des faits sur les lieux de la scène de l’homicide. Pour nous, cette reconstitution a eu lieu dans le bureau du juge d’instruction. Pareil pour les expertises judiciaires, sur lesquelles il n’y a pas vraiment de visibilité ni de transparence.
On demande aussi la mise en place d’une assistance psychologique et de garantir la prise en charge complète des soins consécutifs à des violences d’État : je pense aux mutilés lors des manifestations. Et engager la responsabilité des médecins intervenant dans des procédures judiciaires, comme les gardes à vue. Et bien évidemment, l’interdiction des techniques d’interpellation, comme les plaquages au sol ou les clefs d’étranglement, officiellement interdites] , mais toujours utilisées dans les quartiers ou aux frontières. Ainsi que des contrôles au faciès. Des personnes peuvent se faire contrôler je ne sais combien de fois dans la même journée. L’idéal serait que la police arrête de contrôler tout court, mais il faudrait au moins qu’un récépissé soit remis à la personne où figure le motif du contrôle. Et que ces récépissés soient eux-mêmes vérifiés : parce que contrôler la même personne dix fois dans une même journée, pour dix fois le même motif, ce n’est pas un contrôle de routine…
En recensant les décès, on constate que de plus en plus de personnes en souffrance psychologique sont tuées, ou des personnes en état d’ébriété qui décèdent en cellule, ou même à la suite d’interventions pour violences conjugales. Que pensez-vous d’investir dans d’autres services publics que la police, comme ce que défend le mouvement Defund the Police, aux États-Unis ?
Le constat est que beaucoup de pouvoir a été donné au corps policier, dont des budgets conséquents pour son armement. Et énormément de démarches passent par le commissariat : pour une déclaration de perte de clés, pour une dégradation pour faire jouer ton assurance… Par exemple, il faut un service qui soit détaché du commissariat pour accueillir les personnes qui subissent des violences conjugales, ce serait une idée.
Quand une personne est, comme ils disent, « agitée », en souffrance psychologique, pourquoi c’est la police qui intervient ? Il y a des professionnels pour ça. C’est une question que se pose Awa Gueye, la sœur de Babacar Gueye, tué par la BAC de Rennes en décembre 2015 alors qu’il était en décompensation et avait besoin d’une assistance psychologique. Son ami avait appelé le Samu, et c’est la BAC qui est arrivée… Il est plus que primordial que la société civile, c’est-à-dire nous, madame et monsieur tout le monde, surveille la police et que la justice fasse réellement son travail. Les agentes et les agents assermentés ne doivent pas être au-dessus des lois.
Faisons face ensemble !
Si les 5000 personnes qui nous lisent chaque semaine (400 000/an) faisaient un don ne serait-ce que de 1€, 2€ ou 3€/mois (0,34€, 0,68€ ou 1,02€ après déduction d’impôts), la rédaction de Rapports de force pourrait compter 4 journalistes à temps complets (au lieu de trois à tiers temps) pour fabriquer le journal. Et ainsi faire beaucoup plus et bien mieux.