Né en dehors des cadres traditionnels, le mouvement « Bloquons tout » s’impose comme le point de départ de la rentrée sociale. Si le mot d’ordre du jour mettait en avant les blocages, ce sont avant tout les manifestations qui ont été réussies, avec plus de 200 000 participants dans tout le pays. La jeunesse y a largement contribué.
« Je n’avais pas manifesté depuis…avant le Covid ! », s’aperçoit Tewfik, trentenaire toulousain. C’était une des inconnues de la journée. Un mouvement né sur internet dans l’été, qui a franchi une étape en réunissant plus de 15 000 personnes dans quelque 150 AG en août, pouvait-il passer le cap de la massification ? Ce 10 septembre, la réponse est clairement oui, notamment grâce à la mobilisation des lycéens, étudiants ou encore des jeunes travailleurs.
Le ministère de l’Intérieur annonce pour l’heure 430 actions dont 273 rassemblements et 157 blocages, réunissant 29 000 participants sur tout le territoire. Les remontées de terrain par ville mobilisée, d’après nos propres observations ou contacts locaux, indiquent qu’au moins 100 000 manifestants se sont mobilisés. Sur les coups de 19 heures, le ministère de l’Intérieur a annoncé 175 000 manifestants, la CGT 250 000.
Dès le matin, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Marseille (8000 selon la police, 80 000 selon la CGT). À Montpellier, après les actions de la matinée, un flot continu de manifestants a gagné la place de la Comédie. Rapidement saturée, la place a vu s’élancer un cortège massif d’environ 10 000 personnes (6 000 selon la préfecture). Après deux heures de marche autour du cœur de ville, le défilé a été repoussé par des gaz lacrymogènes et un canon à eau.
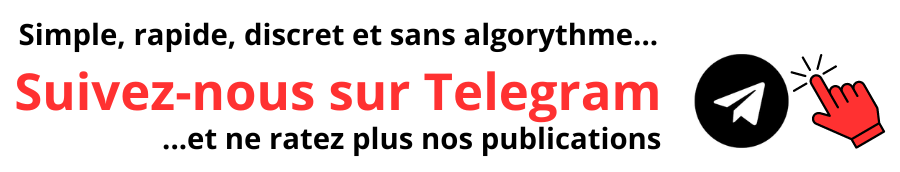
À Lyon, le rendez-vous donné par la CGT et Solidaires en milieu de journée a également attiré énormément de monde. La foule a débordé de la place Guichard. La préfecture a comptabilisé 3000 personnes sur la place, puis 8000 dans la manifestation sauvage qui s’en est suivie. A Nantes, les manifestations ont réuni 3000 personnes selon la préfecture. Selon nos sources, plutôt entre 5000 et 6000. À Bordeaux, environ 7000 personnes selon Ici Gironde, 12 000 selon les organisateurs ont manifesté ou encore 4 500 dans plusieurs communes du Finistère. À Toulouse, la manifestation surprend par son ampleur : 13 000 personnes selon la préfecture, 30 000 pour la CGT. Les chants, les clappings et les slogans combatifs rythment les cortèges. La joie d’avoir réussi la journée se fait sentir. A Rennes, Ouest France comptabilise 15 000 manifestants, la préfecture en annonce 10 500.
À Paris et sa proche banlieue, les différents points de rassemblement et de blocages ont convergé en début d’après-midi vers le secteur de Châtelet-Les Halles, le cœur commercial et touristique de la capitale. Plusieurs milliers de personnes ont alors rempli les rues étroites autour de la place du Châtelet, avant de partir par petites grappes de manifestants sur différents axes vers le nord de la capitale.
Blocages et déblocages
« Bloquons-tout » était le mot d’ordre du jour : les manifestants ont tenté de l’appliquer dès le petit matin. De très nombreux barrages filtrants ou complets se sont déployés aux quatre coins du pays.
Certaines actions ont partiellement réussi : à Rennes par exemple, le blocage de la rocade à partir de 7h30 a été partiellement débloqué à partir de 8h par les forces de l’ordre mais la circulation est restée très perturbée toute la journée.
Ceci étant, la consigne donnée par Bruno Retailleau aux préfets d’empêcher les blocages stratégiques a été suivie à la lettre et efficace. 80 000 agents ont été déployés à cet effet. À Lyon, « les forces de police se sont acharnées à intervenir de façon systématique sur tous les blocages », explique le secrétaire départemental de Solidaires. Une tendance que l’on retrouve un peu partout sur le territoire. A Toulouse, entre 500 et 1000 personnes ont participé aux blocages de la matinée. Ils ont souvent navigué d’un point de rassemblement à un autre, aux grès des flots de lacrymogène. « On a réussi à bloquer des ronds-points, mais les déviations routières nous contournaient vite. Parfois, on s’est limité aux barrages filtrants, les automobilistes n’étaient pas hostiles, ça nous a fait du bien », confie un manifestant.
Les tentatives de blocages des portes de Paris et du périphérique ont ainsi été vite contrées par la forte pression policière. La Brav-M, unité particulièrement mobile et contestée pour sa violence, a même été déployée pour empêcher le blocage Porte de Montreuil, en plus de l’usage, comme ailleurs, des gaz lacrymogènes.
La répression du mouvement ne s’est pas concentrée uniquement sur les points de blocage. En fin d’après-midi, le parquet de Paris dénombrait 199 interpellations et 99 placements en garde à vue. Dans toute la France, le ministère de l’Intérieur communiquait en milieu d’après-midi sur 295 arrestations.
Dans la capitale, alors que les cheminots avaient donné rendez-vous à l’ensemble du mouvement social à 11h Gare du Nord – avec Sud Rail comme l’une des principales forces à l’initiative -, la police a dispersé les manifestants avant même l’heure du rendez-vous. Les quelques centaines de personnes qui ont réussi à se regrouper ont été nassées puis bloquées dans les rues alentour pour éloigner la presse et les citoyens tentant de rejoindre le cortège. Rapports de Force a observé le matraquage de la première ligne de manifestants, composée principalement de jeunes et de quelques syndiqués Solidaires, pour empêcher le cortège d’avancer. La Brav-M a été déployée plus tard dans l’après-midi dans les rues de la capitale.
La jeunesse fortement mobilisée
Dans les rassemblements et manifestations partout en France, la jeunesse était très largement représentée. Les lycéens, étudiants et jeunes étaient ainsi au cœur du mouvement social, aux côtés de syndicalistes et travailleurs en grève cependant moins visibles, et de diverses associations et collectifs citoyens (Droit au Logement, Extinction Rébellion, Urgence Palestine, collectifs de soutien aux exilés,…).
« Dès que j’ai entendu parler du 10 septembre, j’étais emballé. Même si au début ça partait de réseaux un petit peu bizarres », raconte Tim, jeune boulanger toulousain, venu avec ses amis rencontrés en soirée techno. Même si on sait que la manifestation à elle seule ne va pas faire tomber le gouvernement ça fait du bien de se retrouver et d’être nombreux. Le mépris qu’on subit est hallucinant. »
Des actions ont été menées dans 150 lycées, selon l’Union syndicale lycéenne. Un certain nombre d’universités ont été bloquées également, comme à Montpellier (lettres) ou à Lyon. « Le campus principal de Lyon 1 (science) a été bloqué ce matin, en plus de ceux de Lyon 2 et Lyon 3, ce qui est historique » nous confiait un syndicaliste de Solidaires y travaillant. Le ministère de l’Éducation nationale évoque une centaine de lycées perturbés et 27 bloqués en France.
L’Union étudiante, organisation regroupant des syndicats et associations d’étudiants, recense 80 000 jeunes dans la rue – étudiants, lycéens, jeunes déjà salariés -, à partir de remontées obtenues de ses sections locales dans une quarantaine de villes universitaires. Une forte présence de la jeunesse que nous avons pu constater dans les manifestations ou sur les blocages que nous avons suivis et que nous ont confirmé des sources syndicales dans plusieurs villes.
Des grèves limitées, mais l’envie de « nouvelles jonctions »
Du côté des entreprises et de la fonction publique, les mouvements de grève sont restés limités ce 10 septembre. La date du 18 septembre appelée par 8 organisations syndicales semble être la ligne de mire privilégiée par nombre de salariés. Ceci étant, des piquets et blocages d’entreprises, comme à l’entrepôt Amazon de Brétigny-sur-Orge, par exemple, ont fait partie de l’agenda des mobilisations du jour. A Toulouse, les manifestants et syndicalistes du groupe ont tracté devant un site Airbus.
Selon le gouvernement en milieu d’après-midi, 4,14% de grévistes ont été recensés dans la Fonction publique de l’Etat, 6,5% dans l’enseignement secondaire, 4,20% pour la Fonction publique territoriale.
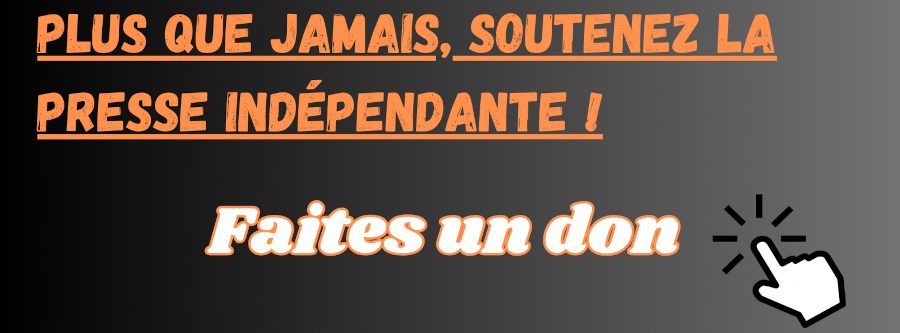
À Paris, le personnel hospitalier en grève s’est concentré devant l’hôpital Tenon puis dans les cortèges. Que ce soit Bayrou ou maintenant Lecornu, « on ne se fait pas d’illusion : si on veut changer notre sort, c’est là, maintenant » veut croire Aurélie, infirmière depuis 25 ans, syndiquée CGT à l’hôpital Saint-Antoine. Elle et ses collègues voient dans le 10 septembre l’occasion de « nouvelles jonctions » entre travailleurs : « des postiers sont venus nous rejoindre à l’hôpital ; puis, on a rejoint les cheminots dans les gares en fin de matinée. »
Quelques militants d’extrême droite en embuscade
Enfin, l’extrême-droite a été largement tenue à l’écart de cette journée du 10 septembre. Quelques militants ont toutefois tenté de faire acte de présence.
Le collectif fémonationaliste Némésis a tenté une incursion dans le rassemblement antiraciste de Place de la République. Alors que les prises de parole et chants en soutien à la Palestine, aux collectifs de mineurs isolés ou encore aux personnes trans se succédaient dans le calme sur la place remplie aux deux tiers, cinq militantes de Nemesis ont tenté de s’approcher. Vêtus de t-shirt bleus siglés « coût de l’immigration », « coût de l’aide médicale d’Etat » affichant chaque fois plusieurs milliards d’euros, elles se sont retrouvées face à une barrière de chants antifascistes. En cinq minutes à peine, les militantes ont été repoussées de la place, protégées à la fin de leur exfiltration par les forces de l’ordre.
Par contre, à Lyon, une quinzaine de militants d’extrême droite ont chargé des jeunes qui tenaient un blocage devant le lycée Saint-Just.
Plusieurs assemblées générales et rassemblements sont prévus en cette fin de journée pour décider des suites du mouvement, dans les centres-villes, les facs et les lieux de travail mobilisés. « Il faut que les travailleurs, dès demain, partout sur leur lieu de travail, se réunissent pour préparer la suite », soutient Aurélie, l’infirmière depuis 25 ans. Dans son hôpital de Saint-Antoine, l’un des plus importants de l’AP-HP, Aurélie et ses collègues ont déjà prévu une AG demain pour décider de la poursuite de leur grève.
*L’article a été mis à jour à 18h55 le 10/09 avec les derniers chiffres des manifestations.
Crédit photo : Ricardo Parreira
Texte : Maïa Courtois, Stéphane Ortega, Guillaume Bernard
Faisons face ensemble !
Si les 5000 personnes qui nous lisent chaque semaine (400 000/an) faisaient un don ne serait-ce que de 1€, 2€ ou 3€/mois (0,34€, 0,68€ ou 1,02€ après déduction d’impôts), la rédaction de Rapports de force pourrait compter 4 journalistes à temps complets (au lieu de trois à tiers temps) pour fabriquer le journal. Et ainsi faire beaucoup plus et bien mieux.

