Un mouvement citoyen parti d’internet peut-il se transformer en grève ? Si la France ne sera pas paralysée par les arrêts de travail ce 10 septembre, la réussite des blocages du jour et le niveau de participation au mouvement pourraient donner de l’énergie dans les entreprises.
Cent mille manifestant·es attendu·es dans les rues le 10 septembre 2025, prophétisent déjà les renseignements territoriaux. Mais combien en grève et quels effets sur l’appareil productif ? L’appel citoyen « Bloquons Tout » est né sur internet dans le courant de l’été. Il est désormais concrétisé par l’organisation de plus d’une centaine d’assemblées générales un peu partout en France (voir notre article) et des appels au blocage. Mais il a aussi été complété par des appels à la grève. Objectif : s’opposer au budget d’austérité voulu par le gouvernement Bayrou.
Rembobinons. Dès le début du mois d’août, plusieurs fédérations de la CGT, comme la FNIC-CGT (industries chimiques), la CGT commerce et service, ou certaines unions départementales, comme celle du Nord, ont appelé à se joindre au mouvement du 10 septembre par la grève. Finalement, le 27 août, la confédération CGT a décidé d’inclure le 10 septembre à son agenda de mobilisation du mois. Pas un appel ferme à la grève mais une incitation à « débattre avec les salariés et à construire la grève partout où c’est possible », qui révèle une sympathie pour le mouvement citoyen.
Côté Solidaires, de grosses fédérations professionnelles (Sud-Rail, Sud-Industrie, Sud-PTT et Finances publiques) ont également appelé à cesser le travail. « Avec le recul, on se dit qu’on a bien fait, ça a permis d’accélérer les choses. Peut-être même le départ de Bayrou », suggère Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sud-Rail, troisième syndicat à la SNCF.
Le 27 août, l’union syndicale Solidaires toute entière a finalement opté pour un appel à la grève et au blocage. La Confédération paysanne s’est elle aussi jointe au mouvement. La date du 10 septembre n’a toutefois pas été retenue par l’intersyndicale (FO, CFDT, CFE-CGC, Solidaires, CGT, CFTC et UNSA) qui lui a préféré celle du 18 septembre pour une « journée de mobilisation y compris par la grève et la manifestation ».
Quels appels à la grève ?
Depuis, les appels se sont multipliés dans les entreprises, les unions locales et les fédérations de Solidaires et de la CGT. Ils donnent une première idée du niveau de grève dans les secteurs les plus syndiqués. Côté transport, la CGT-Cheminot, premier syndicat à la SNCF, s’est joint à l’appel de SUD-Rail et prône la grève le 10 septembre. Ce n’est toutefois pas le cas de l’UNSA-Ferroviaire, deuxième syndicat du secteur. « On a plutôt de bons retours des salariés, la grève sera suivie correctement même si ce ne sera pas the big grève », précise Fabien Villedieu de Sud-Rail. À la RATP, Force Ouvrière, syndicat majoritaire dans le groupe, ne prend pas part au 10 septembre. Mais la CGT, deuxième syndicat, ainsi que La Base, syndicat majoritaire chez les conducteurs de RER, ont appelé à la grève, ce qui devrait perturber les transports en commun parisiens et franciliens.
Les énergéticiens de la CGT seront également mobilisés le 10 septembre. Hasard du calendrier, la date coïncide avec un appel à la grève reconductible lancé avant l’été par la fédération mines et énergie de la CGT (FNME-CGT), première force syndicale du secteur. Après une première semaine de grève bien suivie, du 2 au 5 septembre, la première fédération du secteur des industries électriques et gazières (IEG) a appelé à poursuivre son mouvement pendant encore deux semaines. Le projet n’est pas d’instaurer un arrêt de travail continu sur l’ensemble de ces jours mais de décliner divers moyens comme les débrayages stratégies ou les filtrages. « Cette fois, on s’est donné le lundi et le vendredi pour aller à la rencontre des salariés et les 3 autres jours pour mener des actions. Les dates du 10 et du 18 tombent en plein dans notre calendrier de mobilisation. On a voulu pleinement s’y impliquer », explique Fabrice Coudour, secrétaire général de la FNME-CGT.
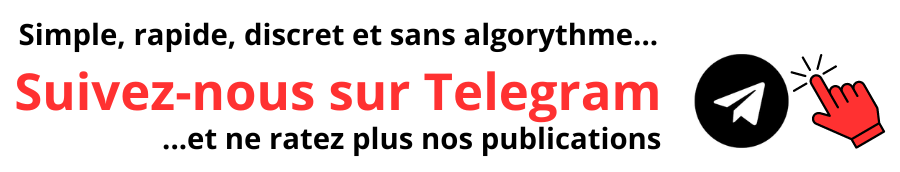
D’autres secteurs manquent toutefois à l’appel. C’est le cas des enseignants, dont les plus gros syndicats du premier et second degré (Snuipp-FSU et SNES-FSU) n’ont pas publié d’appel ferme à la grève pour le 10 septembre, à la différence de la CGT-Educ’action et de Sud-Education. « Ce n’est pas facile de mobiliser les enseignants un mercredi. Dans le 1er degré, beaucoup ne travaillent pas. Mais il est probable qu’ils rejoignent des actions ou des manifestations ce jour-là », explique Laurent Feisthauer, secrétaire général de l’UD CGT 67 et enseignant retraité. La puissante fédération CGT des Ports et docks, en capacité de bloquer de nombreux nœuds maritimes les jours de mobilisation, n’a pour l’heure pas non plus appelé à rejoindre le 10. Les dockers et portuaires sortent d’une longue bataille autour de la défense de leurs retraites. Dans les raffineries, où la CGT garde un certain pouvoir de blocage, des appels à des grèves et des débrayages de quelques heures ont été lancés, notamment par la CGT TotalÉnergies, pas de quoi mettre à l’arrêt le raffinage.
Un appel ne fait pas une grève
Lancer un appel est une chose, mettre massivement les salariés en grève en est une autre. « On a eu une réunion cette semaine à l’union locale (UL). Peu de camarades étaient en capacité de lancer des grèves dans leurs entreprises le 10 septembre. On est très proche de la rentrée et les gens semblent privilégier le 18 septembre », constate Yoan Piktoroff, secrétaire général de l’UL CGT d’Aubervilliers (93). La proximité des deux dates de septembre « ne simplifie pas forcément la tâche », souligne Fabien Villedieu, tout comme le très probable départ de François Bayrou, qui pousse certaines salariés « à se demander pourquoi ils vont faire grève », poursuit le cheminot.
Plusieurs syndicalistes notent que la mobilisation du 10 fait toutefois réagir dans leur syndicat. « Je reçois des appels surprenants. Des primo-grévistes qui passent un coup de fil à l’union départementale (UD) pour demander comment faire grève », raconte Laurent Feisthauer de la CGT 67. « On a 90% à 95% des votes pour le 10 dans les réunions syndicales, on n’avait pas ça pour les gilets jaunes », témoigne Cédric Volait, coordinateur CGT-santé en PACA. « On n’en est pas encore à toucher le cercle des adhérents éloignés de la vie syndicale. Mais le 10 est un début », conclut Yoan Piktoroff. Chiffres importants à garder en tête : en 2023, seuls 2,7% des entreprises avaient connu une grève dans l’année, selon l’INSEE. Plus l’entreprise est grosse, plus ce pourcentage augmente. Et il monte à 16,6% lorsque l’entreprise en question dispose d’un délégué syndical.
S’approprier sa grève ?
Si une grève interprofessionnelle massive ne semble pas à l’ordre du jour le 10 septembre, des syndicalistes notent un phénomène intéressant : le développement d’AG dans les entreprises et les locaux syndicaux. « À Digne et à Manosque, le personnel hospitalier a déjà prévu des AG le 10 pour décider des suites à donner au mouvement », suggère Cédric Volait. De même, à la bourse du travail de Paris, les secteurs de l’hôtellerie restauration et de l’informatique se préparent pour des assemblées générales le 8 et le 10 septembre à l’appel de différents syndicats et de collectifs.
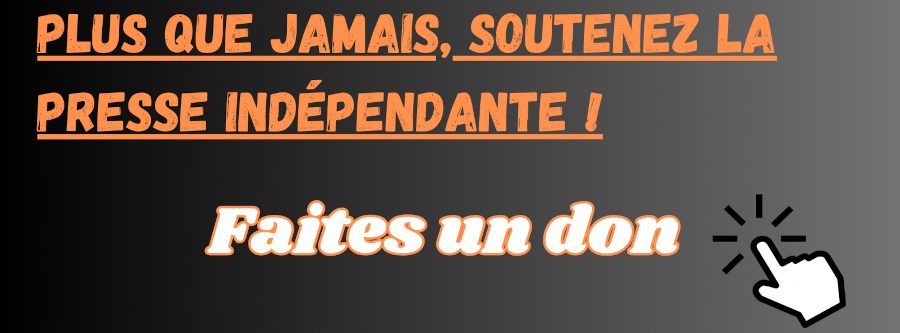
Cédric Volait, qui a organisé de nombreux rassemblements, finalement victorieux, mêlant habitants, gilets jaunes et salariés, contre la fermeture des urgences de Sisteron (06) a longtemps conjugué mouvement citoyen et lutte syndicale. « Dans la santé, le droit de grève est tellement contraint que cela nous pousse à envisager d’autres modes d’action. Camper devant les locaux, bloquer les parkings, cela devait se faire avec l’appuie des citoyens…Mais pour sortir des actions habituelles, il faut que les salariés s’emparent de leur lutte et décident eux-mêmes de ce qu’ils veulent faire ».
Au cours du mois d’août, près de 12 000 personnes ont participé aux assemblées générales de préparation du mouvement dans plus de 150 communes. La réussite des blocages citoyens du jour, et le niveau de participation au mouvement, pourrait aussi donner de l’énergie dans les entreprises.
Crédit photo : Guillaume Bernard
Faisons face ensemble !
Si les 5000 personnes qui nous lisent chaque semaine (400 000/an) faisaient un don ne serait-ce que de 1€, 2€ ou 3€/mois (0,34€, 0,68€ ou 1,02€ après déduction d’impôts), la rédaction de Rapports de force pourrait compter 4 journalistes à temps complets (au lieu de trois à tiers temps) pour fabriquer le journal. Et ainsi faire beaucoup plus et bien mieux.

